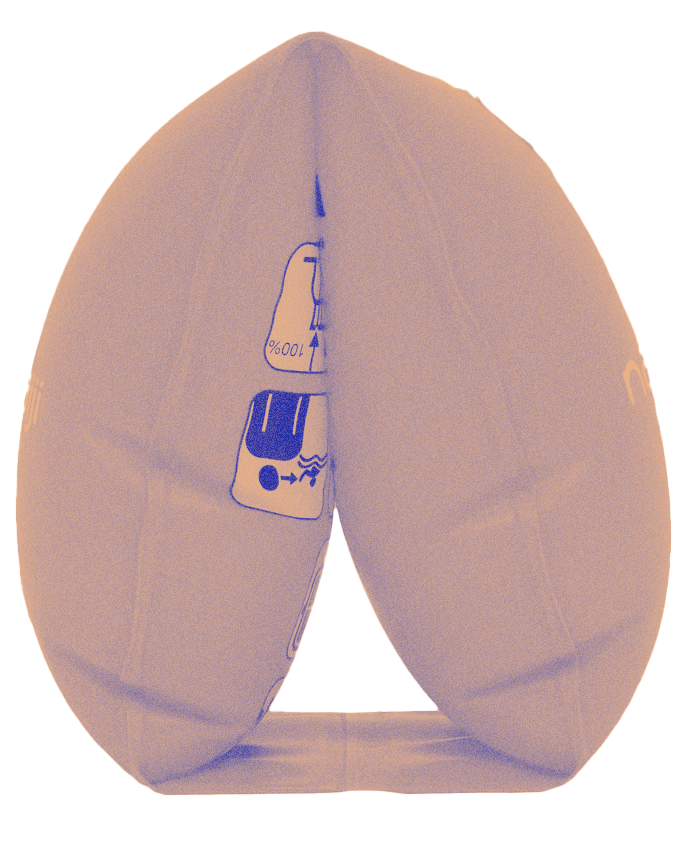Textes
Le jeudi 9 janvier 2025, je reçois dans ma boîte aux lettres une carte postale du Sénégal. J’ai d’abord cru à une publicité pour des bicyclettes. Un vélo couvert de bassines et de seaux, de toutes les tailles, aux couleurs arc en ciel, attachés les uns aux autres comme des grappes en plastique. C’est très sculptural. Cette carte est plié en bas à gauche, j’aime bien les cartes comme celle-là. De l’autre côté, on peut lire une courte phrase adressée par Charlotte Hubert : « Un jour viendra où j’habiterai ici. »
Cet entretien sous forme de dialogue, arpente plusieurs notions dont celle du déplacement, tant ancrée dans la performance narrative de l’artiste, qu’imprégnée des enseignements d’Orlan, d’Agnès Varda et de Mélanie Klein.
Nous parlons de sa démarche artistique, ses voyages, rencontres, de ce qui est jeu et en Je dans son travail.
Attention, elle me prévient qu’elle me raconte peut-être des salades.
Léo Bioret : Introduire ton travail, c’est un peu comme prendre l’apéritif pour débriefer des vacances en passant des diapositives.
Charlotte Hubert : Je parlerai de mes vacances en Grèce quand j’avais à peu près dix ans avec mes parents et mon frère. Ça m’avait marquée parce que cette année-là, mon père avait un mini slip de bain noir avec une petite ficelle. Quand il s’allongeait sur le sable, le slip de bain ne recouvrait pas toutes ses fesses. Cette bande sur le haut-fessier de mon père pendant les vacances en Grèce, ça, c’est un sujet à la fois intime et artistique.
L. B. : Vous en reparlez des fois en réunion de famille ?
C. H. : Oui, avec ma famille japonaise.
L. B. : Qu’est-ce que tu bois pour cet apéritif de débrief ?
C. H. : Du saké
L. B. : Très bon choix, chaud ou froid ?
C. H. : Hotto sake
L. B. : Histoire ou poésie ?
C. H. : Des récits poétiques.
En 2016, j’ai travaillé en Iran, j’étais invitée à donner des cours à l’université de Téhéran. J’ai été happée par la poésie, il y en a partout, même sur les murs dans l’espace public. Tout se passe avec les mots, dans l’écriture. À Shiraz, j’ai découvert que les oiseaux lisaient dans l’avenir. De cette expérience-là, j’ai écrit ma performance Le langage des oiseaux. D’ailleurs, je viens de finir la rédaction d’un recueil de poésie. Sans filet, l’écriture est prise dans les souvenirs écrans, ce qu’il reste de l’enfance, qui fait image dans la psyché, l’inavouable en somme.
L. B. : Partition ou chanson ?
C. H. : Je choisis la chanson, Mourir sur scène de Dalida.
L. B. : Performance ou blabla ?
C. H. : La la langue.
L. B. : La la langue ?
C. H. : C’est un concept psychanalytique, quand le langage vient à l’enfant.
L. B. : La famille royale d’Angleterre ou l’équipe de la piscine municipale ?
C. H. : Ah, la princesse Margaret du Royaume-Uni, est ma préférée !
Je m’intéresse beaucoup à cette famille royale pathogène. J’aime beaucoup la place de seconde de Margaret, qui aurait voulu être première, mais qui finalement a quand même joui de plus de liberté qu’Elisabeth. J’aime ses amants, ses robes, ses cigarettes. C’est Margaret, sans hésiter. Si j’avais eu une fille, je l’aurais appelée Margaret.
L. B. : Immergeons-nous.
Lorsque je plonge dans ta recherche et ton travail d’écriture, je découvre une performance narrative très aquatique : les tritons, les mouettes, le thé, le toboggan, les sirènes, les nuages, Les dents de la mer, le jacuzzi, … Alors, pourquoi écrire les pieds dans l’eau ?
C. H. : J’ai grandi en grande partie au bord de l’eau, dans deux magasins de photographie, avec cette vue privilégiée sur l’océan. L’eau est pour moi une sorte de miroir, dans lequel les images, les récits, les pensées, viennent se refléter. Je me vois et j’interroge ma pratique en permanence dans les reflets de l’eau. C’est pour ça que c’est si présent.
L. B. : Elles sont là, à chaque fois, les perruques, les lunettes, les casquettes, les paillettes, les frites. Est-ce l’accessoire qui fait la différence ?
C. H. : Ah oui, oui, oui. Le déguisement est très lié à mon enfance. J’ai passé des heures, déguisée dans la ville de Pornic. J’enquêtais avec un petit micro et des chaussures dix fois trop grandes. J’ai toujours aimé me déguiser, ça m’a toujours emmenée ailleurs. L’accessoire est une forme de libération qui m’aide à endosser un nouveau rôle.
L. B. : Le lien entre les mots et leur étymologie capillotractée apportent à la fois une dimension théorique et humoristique mais aussi engagée et improbable au moment de la performance. Comment penses-tu cette recette narrative ?
C. H. : Je ne sais pas faire autrement que d’écrire et de raconter des histoires. C’est la langue qui m’intéresse, j’écris à partir des lieux qui m’invitent, d’échanges avec d’autres artistes, et des images aussi. J’ai une écriture de plasticienne, je ne peux pas écrire sans l’idée d’une action derrière. Je m’appuie beaucoup sur l’histoire de l’art. C’est un ping-pong permanent entre les images que j’ai sous les yeux pour travailler, le contexte et la manière dont je pourrais mettre en acte et en mots cette écriture.
L. B. : Tu enseignes la performance depuis une dizaine d’années notamment à l’université et dans le secondaire comme professeure d’arts plastiques. Quelle place donnes-tu à la transmission ?
C. H. : On dit souvent de mon travail, que je fais des trucs rigolos, que c’est un peu barré, c’est vrai ; mais j’aime le sens produit par la construction du récit. L’idée, c’est d’y trouver et d’y mettre du sens. C’est pour cela que j’aime enseigner, parce qu’il y a aussi dans l’enseignement cette posture de l’orateur, ce qui me donne l’impression de faire une performance. L’enseignant•e en arts plastiques est là pour faire émerger des singularités : celle d’une parole, d’un être, d’un parlêtre, d’un•e artiste. Nous sommes là pour poser un cadre, faire en sorte que le transfert s’opère, faire advenir un désir de création. Nous appuyons par petites touches, nous ne sommes surtout pas là pour modéliser, ni pour dire à l’étudiant•e ce qu’il•elle doit faire ou comment il•elle doit formaliser. C’est là tout l’enjeu de la pédagogie des arts plastiques. J’ai aussi enseigné la didactique des arts plastiques à l’université dans une option MEEF pendant deux ans. Cela m’a fait réfléchir à ma position pédagogique, à mon rapport à la psychanalyse, à ma posture d’artiste. C’est un fil rouge, rien n’est cloisonné. Je pense que tout circule autour de cette question : quelle place donner à l’autre ?
L. B. : Comment ton approche de la psychanalyse nourrit-elle ta pratique artistique ?
C. H. : Il s’agit de deux pans de mon travail qui se répondent. À 32 ans, j’ai repris trois ans d’études à Paris 7. J’ai deux diplômes universitaires en psychanalyse, sur les concepts freudiens et post-freudiens.
À un moment, il m’a semblé important de saisir la théorie psychanalytique, parce que cela faisait déjà très longtemps que j’étais en analyse, et parce que la psychanalyse est cet endroit qui s’intéresse au langage. Elle entre pleinement en résonance avec ma pratique artistique ancrée dans l’oralité et les récits. C’était évident pour moi d’essayer de comprendre ce qu’il y avait derrière tout ça. Je crois à une psychanalyse féministe et décoloniale, c’est un champ disciplinaire qui doit absolument se saisir des enjeux contemporains. Il y a effectivement un aller-retour entre ma façon de travailler et la psychanalyse. Je l’utilise comme un outil, un plongeoir.
L. B. : Ta façon de créer est vraiment connectée à l’association libre, clé de voûte de la psychanalyse.
C. H. : J’aime le concept de l’association libre, il se télescope avec ma façon de créer.
En psychanalyse, au début, on résiste, on contrôle. On ne lâche pas parce qu’on a envie de plaire à son psychanalyste. Moi, il m’a fallu 7-8 ans avant de m’allonger sur le divan, c’est quand même long. Puis un jour, vient à l’esprit un souvenir, et encore un autre, et on lâche, comme un trapéziste. De la même manière, quand j’écris, j’associe librement, je me laisse traverser par les images que j’associe progressivement, comme un puzzle.
L. B. : C’est ça le blabla ?
C. H. : C’est ça le blabla, être à l’écoute de ma petite langue intérieure, parfois lui résister, d’autres fois lui répondre au second degré. Croiser les idées en permanence, entrecroiser les images, entre mon écriture et mon écriture, ou avec celle d’autres femmes.
Comment je passe d’une idée à une autre en me laissant flotter ? L’écoute flottante de l’analyste m’intéresse beaucoup ; l’attention peut être suspendue, le raisonnement en attente, et pourtant il se dit des choses, qui s’écrivent inconsciemment ou pas. Le sentiment océanique me vient également à l’esprit, je ne suis pas mystique, mais ce concept m’intéresse dans le sens où il questionne cette délimitation, entre soi et le monde, cet endroit où l’effondrement est possible, l’endroit de la création ?
L. B. : Mise en voix, mise en lumière, mise en dialogue et mise en plis cohabitent dans tout ton travail d’écriture. Comment fais-tu intervenir ces figures féminines au fil de tes performances ? Gertrude Stein, Hélène Bessette, Nathalie Léger, La comtesse de Ségur, les quatre filles du docteur March, Chantal Goya ou encore la reine d’Angleterre et Isabelle Adjani ? Quelle est ta manière d’écrire autour d’elles et sur elles ?
C. H. : Dans mon travail, soit, j’invite des femmes, soit, j’y fais référence. Je les convoque également à travers mes souvenirs d’enfance : Chantal Goya, la comtesse de Ségur, toutes ces personnages un peu anachroniques, m’intéressent. J’ai toujours à cœur de faire référence dans un axe féministe, à des femmes qui m’ont construite en tant qu’artiste, mais aussi en tant que femme et mère. Il y a un axe politico-poétique dans mon travail. J’ai toujours été vigilante à ces questions politiques en tant qu’artiste, mais également en tant que commissaire d’exposition.
L. B. : Une autre femme importante dans ton travail d’écriture, c’est Clélia Barbut avec qui tu as inventé une discipline manquante au grand panorama des sciences humaines, l’aquagymologie en 2015. Comment est théorisée l’aquagymologie à quatre mains ?
C. H. : Clélia Barbut est une historienne de l’art qui s’intéresse à la plasticité. Elle écrit la partie scientifique et sérieuse. Et moi, je suis une plasticienne qui écrit des histoires. Je rentre dans l’écriture et je fais tout dérailler. J’aime être dans cet espace de l’imposture par rapport au savoir. Comment fait-on dérailler les savoirs académiques ? C’est pour ça que l’aquagymologie est une science du déraillement, mais aussi une forme d’utopie.
L. B. : Et la piscine dans tout ça ?
C. H. : Avec Clélia, on s’est rencontrées lors d’un exercice d’abdos-fessiers à la piscine de la cité universitaire de Paris. Un contexte propice pour décider de créer la science de l’aquagym. C’est une bonne porte d’entrée vers mon travail. On y retrouve : l’écriture, la performance, les images, les vidéos, le corps, les femmes. Je trouve que l’aquagymologie, c’est un peu notre grande recette.
L. B. : Cette recette de la conférence performée tend vers une forme de médiation à plusieurs égards. On retrouve ce dispositif dans d’autres projets comme « La Croisière s’allume ». Vous reprenez les codes et usages de la croisière. Vous proposez une visite au public d’un bateau-mouche avec Clélia, toujours éclairée de ce déraillement poétique et féministe. L’acte de création devient alors la médiation performée.
C. H. : Ce qui m’intéresse, c’est ce petit pas de côté, qui vient tout mettre en lumière. Pourquoi est-ce une œuvre d’art et pas une médiation ? Pourquoi est-ce une performance et pas une conférence ? Ce que je raconte est une autre façon de faire et de voir l’histoire de l’art, par les récits et la fiction. Il faut aussi déplacer cette histoire de l’art avec un grand H, Hyper Hétéropatriarcal. Il y a plus d’une dizaine d’années, je réalisais des audioguides lorsque j’étais invitée dans une exposition collective. J’écrivais alors fictions et poésies à partir du travail des artistes présent•es. J’aime écrire à partir du travail de l’autre, penser et dire des récits en dehors des sentiers battus de la critique d’art.
« On y retrouve : l’écriture, la performance, les images, les vidéos, le corps, les femmes. Je trouve que l’aquagymologie, c’est un peu notre grande recette. »
L. B. : Déplacer la narration, bouger la performance à Kanazawa, à Dakar, à Paris, à Bruxelles, qu’est-ce que cela produit ?
C. H. : J’aime me déplacer ; rencontrer des gens, échanger, c’est en ce sens que ponctuellement, j’endosse le rôle de commissaire d’exposition, qui me permet de créer du lien, d’être avec l’autre. Par exemple, au Japon, j’ai passé beaucoup de temps dans les îles du Pacifique, avec les Ama, ces femmes qui plongent en apnée pour pêcher des coquillages et qui ramènent des perles. À Kamishima, sur l’île de la chèvre dans cette communauté de femmes, j’ai déchargé le poisson et mangé du poulpe au petit-déjeuner. Je suis allée au moins trois fois sur ces îles. J’avais ensuite une résidence à Tokyo en lien avec ce projet. À travers l’expérience, Il s’agit pour moi de m’immerger dans des nouveaux contextes culturels, de les traverser et non pas de m’en accaparer.
L. B. : Tu retournes bientôt au Japon avec une production en cours, « Some Love Letters ».
C. H. : En ce moment, je fais des œuvres un peu plus formelles pour essayer de les vendre. Je suis invitée par la LOWW gallery à Tokyo en février 2025, où j’expose une série de collages de lettres d’amour. Évidemment, ce sont des collages alimentés par les magazines féminins des années 50, où l’on trouve tous les conseils pour être de bonnes épouses, de bonnes mères et de bonnes catholiques.
Il y a toujours quelque chose de performatif dans le geste de coller sur une feuille, encore une fois j’associe librement les images et les mots entre eux. On retrouve du langage dans beaucoup de mes collages. D’ailleurs, à l’université, ces dernières années, j’ai enseigné la performance et son lien aux avant-gardes, notamment à travers le dadaïsme et le surréalisme, né avec la psychanalyse. On retrouve d’ailleurs dans ce mouvement beaucoup le principe de collages. Le collage vient faire sens dans mon travail comme une aventure de l’inconscient, un cadavre exquis qui fait le lien au performatif.
L. B. : C’est ça le blabla ?
C. H. : C’est ça le blabla, être à l’écoute de ma petite langue intérieure, parfois lui résister, d’autres fois lui répondre au second degré. Croiser les idées en permanence, entrecroiser les images, entre mon écriture et mon écriture, ou avec celle d’autres femmes.
Comment je passe d’une idée à une autre en me laissant flotter ? L’écoute flottante de l’analyste m’intéresse beaucoup ; l’attention peut être suspendue, le raisonnement en attente, et pourtant il se dit des choses, qui s’écrivent inconsciemment ou pas. Le sentiment océanique me vient également à l’esprit, je ne suis pas mystique, mais ce concept m’intéresse dans le sens où il questionne cette délimitation, entre soi et le monde, cet endroit où l’effondrement est possible, l’endroit de la création ?
L. B. : Cette année, le collectif BLAST te propose d’éprouver un mois de résidence. Comment abordes-tu ce temps de recherche ?
C. H. : La spécificité des résidences de BLAST, c’est le temps de recherche où les artistes peuvent à la fois terminer un projet, mais aussi en présenter une étape. J’ai donc décidé de travailler directement avec le territoire angevin. J’écris une nouvelle performance sur le Roi René d’Anjou.
L. B. : Raconte-moi ta rencontre avec René ?
C. H. : Son portrait m’attirait beaucoup parce qu’il était quand même particulièrement laid, ce René. Ensuite, ma question est la suivante : René, était-il si bon ?
L. B. : Mènes-tu une enquête pour répondre à cette question ?
C. H. : Une enquête qui passe comme d’habitude par la recherche, les lectures et la rencontre. Il se trouve que j’ai rencontré par hasard, sur le site de la résidence, une spécialiste du Roi René d’Anjou, Juliette Besson-Pointeau. J’apprends qu’elle a rédigé son mémoire sur René, nous échangeons sur le sujet de ma résidence et nous nous sommes mises à travailler ensemble.
Elle sur la partie historique et moi sur la partie plastique, pour présenter une performance, lors de la soirée d’ouverture le 24 janvier. Cela me semblait pertinent de travailler sur l’histoire de l’Anjou à travers ses récits et figures emblématiques. Je vais aussi amener la question du féminisme, essayer de mettre en lumière les relations de René d’Anjou aux femmes, qui était un personnage à la fois attachant et pathétique. J’ai choisi l’axe de la vie sentimentale du roi pour faire dérailler un peu l’Histoire du côté des tabloïds. La performance prendra la forme d’un entretien de plateau télé. Tu imagines bien qu’en partant de René d’Anjou, je digresse vite vers René Angélil de Céline Dion. L’humour est important pour moi, il me permet de sublimer, de dire l’indicible. Faire rire me plaît, c’est un pas de côté libérateur qui me permet de créer facilement du lien avec le visiteur, spectateur.
C. H. : Peux-tu remettre la carte postale du Sénégal à l’écran ? Je vais faire une capture.
L. B. : Alors, attends. Là, tu la vois bien ?
C. H. : Essaye de la mettre plus en arrière que je te vois un peu aussi.
L. B. : J’essaye de mettre mon nez à fleur de la carte, c’est très dur.
C. H. : Je veux bien le verso de la carte maintenant, merci.
Léo Bioret – Blabla avec Charlotte Hubert, en direct Live de son atelier et de sa résidence au collectif BLAST en décembre 2024 et janvier 2025.
Léo Bioret – 2024